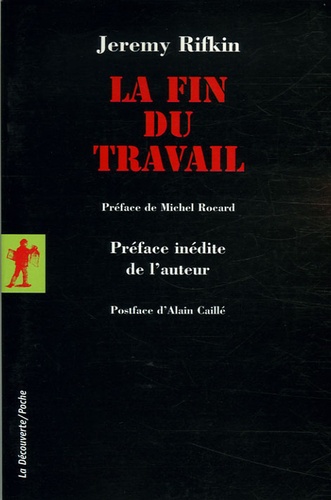American Apparel est un fabricant de vêtements prenant le contre-pied de l’industrie textile : l’usine n’est pas délocalisée, elle n’utilise pas des petits mains asiatiques, et l’impact environnemental est pris en compte. Ce fabricant n’est donc pas un “sweatshop” (j’y reviendrai dans un autre article à propos du livre “No Logo”).
Les employés d’American Apparel sont américains, ils travaillent près de chez eux, dans une belle usine, sont bien payés, et heureux d’avoir ce job.
Alors que tout le monde le donnait perdant dans son entreprise, Dov Charney a persisté dans son idée de lancer sa marque de vêtements sans sous-traiter sa production. “Je voulais prouver que produire dans ce type d’ateliers clandestins, en exploitant ce qui s’apparente à des esclaves modernes revenait finalement plus cher que de produire de manière éthique, aux États-Unis” (“80 hommes pour changer le monde”, p.169). Presque 20 ans plus tard, American Apparel vend dans le monde entier, et persiste sur la voie tracée par son fondateur.
Dov semble aimer les vêtements simple, sans logo, ce qui n’enthousiasmera pas tout le monde, moi y compris ! C’est avec un certain entrain que je suis rentré dans le magasin à Anvers, mais une fois dans les rayons, mon désir de soutenir cette belle entreprise fut un peu refroidi. Malgré tout j’y ai trouvé mon bonheur, et tant pis si personne (ou presque) ne verra que je porte du American Apparel !…